










VIHIERS PATRIMOINE

Sommaire

Château de Maupassant
CHRONOLOGIE
Xe siècle: Vihiers fait partie des domaines de Saint-Hilaire de Poitiers Foulques Nera, comte d'Anjou se rend propriétaire de la terre au milieu du X" siècle Il y construit un château. Il fonde des foires à Vihiers, puis autorise la construction de deux églises (la première dédiée à Saint Hilaire, la seconde à Notre Dame et Saint Jouin) par les moines de Saint-Jouin-de-Marnes. Les droits ecclésiastiques et les droits sur les échanges sont attribués à ces églises. L'autorisation pour la construction d'une troisième église est ensuite attribuée à ces mêmes moines
XIe siècle: La terre de Vihiers est inféodée à Burchard le Velu.
XIIe siècle: Fondation par le Comte d'Anjou de deux nouvelles églises, l'une dédiée a Saint-Jean et desservie par des Fontevristes, l'autre dédiée à Saint Nicolas. desservIe par les moines de Saint-Jouin. Afin de faciliter l'établissement de ces églises le Comte accorde à la première une foire et pour la seconde fait établir un nouveau champ de foire hors du château.
Un petit-fils de Burchard le Velu se fait appeler "consul de Vihiers".
La terre passe, à la fin du XIIe siècle à la famille de Thouars par le mariage de Marguerite de Vihiers avec Guillaume de Thouars.
Début XIVe siècle: La ville de Vihiers est détruite par les Anglais.
XIVe siècle: Marie de Rochefort apporte terres et château à Guy Turpin.
XVIe siècle: Le domaine est érigé en comté (lettres d'août 1577) en faveur de Louis Turpin de Crissé.
1569 - 1594: La ville de Vihiers est prise et en partie détruite par les huguenots puis par une bande de la garnison de Rochefort.
1690: Le fief est mis en vente par les créanciers de la succession de Henri-Charles Turpin de Crissé. Il est acquis par Éléonore de Mesgrigny, sa belle-fille et veuve de Philippe-Charles Turpin.
1706: Éléonore de Mesgrigny épouse en secondes noces Jean Cerdinan, comte de Poitiers. La terre reste ensuite entre les mains des descendants des Turpin de Crissé (Angélique Éléanore Damaris de Turpin de Crissé, épouse Gabriel de Crux, Éléanore Henriette de Poitiers, veuve Blaikart-Maximilien d'Helmstadt qui est dit Comte de Vihiers en 1760).
1771: Hercules Timoléon de Cossé-Brissac se porte acquéreur du fief. Il en est encore seigneur à la Révolution.
1790 (circa): Le château est bien national. Il peut avoir été occupé par l'administration du District de Vihiers créée la même année.
16 mars 1793: Le château est incendié.
début du XIXe siècle: Le château est restitué aux Cossé-Brissac. Il passe ensuite à Marie Maupassant veuve Chauvin de Boissavary, sœur de Charles Maupassant, ancien maire de Saumur. décédé en 1826 dans le château de Vihiers.
1858: Décès de Mme de Boissavary. Son testament du 20 avril 1854 institue la commune de Vihiers légataire du château que l'on appelle alors "Château de Maupassant". avec pour obligation la charge de le transformer en hospice. .
15 janvier 1859: La commune accepte le legs.
1862: Travaux d'appropriation du château. Les travaux, dirigés par l'architecte Bibard sont adjugés le 10 juillet 1862.
1863: Mgr Bompois, vicaire général. supérieur de la Communauté Saint Charles consacre la chapelle aménagée au rez-de-chaussée de la cour.
XXe siècle: Divers travaux d'aménagement du bâtiment qui est désaffecté après la construction d'un hôpital et d'une maison de retraite modernes dans les jardins du parc du château.
1981 - 1996: Etudes et recherches pour la réutilisation du bâtiment.
CONCLUSION
Le Château de Maupassant est donc un édifice composite dont les parties les plus anciennes sont antérieures au début du XIVe siècle. De cet édifice primitif, sans doute ruiné en même temps que la ville par les troupes anglaises il ne subsisterait que le base, en glacis, des maçonneries de la façade nord, un premier tunnel orienté nord-sud et la base de la tour ronde dont la trace est visible sur le mur de soutènement de la terrasse à l'ouest. Ce bâtiment devait être plus large que le bâtiment actuel, il devait s'étendre sur l'emprise du jardin. Seule la conduite de fouilles archéologiques dans le jardin devant la façade sud permettrait de confirmer cette hypothèse. Elle permettrait également de définir, de quelle manière pouvait se poursuivre le souterrain.
Cet édifice aurait été reconstruit sur un plan voisin de celui de bâtiment que nous connaissons, à la fin du XIVe siècle ou au début du XVe siècle. Son élévation précise nous est inconnue. Seuls les percements du rez-de-chaussée de la façade sud peuvent être certainement attribués à cette époque. les percements de l'étage et ceux de la façade sud (en pIerre de tuffeau et non en falun) peuvent être postérieurs. ce qui est confirmé par l'arrachement visible. sous les latrines.
C'est à cette époque que le tunnel (le souterrain) actuel aurait été percé, du moins réaménagé et que l'on aurait construit la salle de garde (appelée communément "la chapelle") pour en garantir l'entrée.
La troisième époque voit la ruine (guerres de religion ?) de ce bâtiment et sa reconstruction. C'est un bâtiment de deux étages avec un étage de combles qui présentait les mêmes percements que le bâtiment actueL il est probable que chaque travée de fenêtres à meneaux s'achevait par une lucarne pendante.
Nous n'avons pas retrouvé de trace d'escalier, deux hypothèses peuvent être formulées: ou l'escalier prenait place devant la façade sud de la tour, cette façade ayant été fortement remaniée, ou l'escalier se trouvait dans une situation proche de celle de l'escalier actuel. Cette deuxième hypothèse supposerait l'existence possible d'un bâtiment en retour.
La quatrième époque du château de Maupassant est au XVIIe siècle lorsque le bâtiment précédent est transformé par la construction de l'escalier que nous connaissons et par une première modification des ornements de la façade sud. Ces modificatIons ne concernent que les moulures et les impostes et cartouches des baies et les bandeaux et corniches. C'est sans doute à cette époque que le jardin aurait été crée. Après les troubles liés aux guerres de Vendée et l'incendie il ne reste plus que les murs du château qui doit être reconstruit. Ces travaux sont exécutés avant 1826 puisque M. de Maupassant décède dans une chambre du château. La façade sud et celles de la tour ne semblent pas avoir été touchées. Suite à l'effondrement des ouvrages en bois lors de l'incendie de 1793, les planchers ont entièrement été reconstruits (avec des bois de récupération), la charpente a été entièrement refaite ainsi que le couvrement de la dernière volée de l'escalier (en briques). Les lucarnes, les corniches, les décors des pilastres, les clôtures du jardin et l'obturation des portes du rez-de-chaussée de la tour semblent dater des travaux d'appropriation pour la maison de retraite.
On a fêté le premier millénaire du château de Vihiers en 2013 !


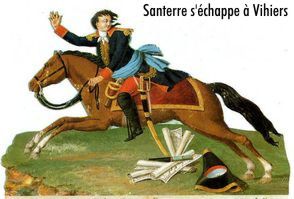

Retour au château de Maupassant